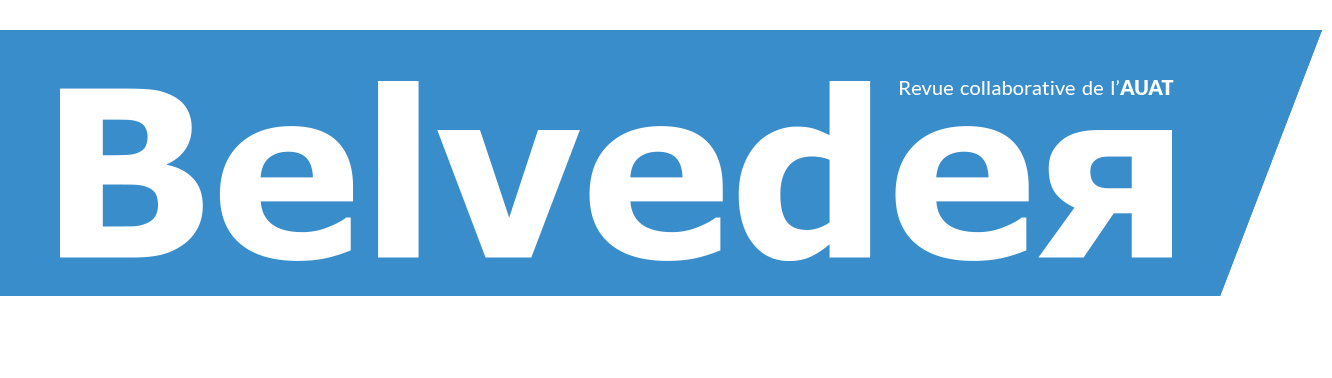Téléchargez l’article au format PDF
Céline Loudier-Malgouyres
Socio-urbaniste
L'usage des lieux
18 h 00 : un jeune homme sort du travail et rentre chez lui, en empruntant les boulevards. En marchant là, il croise d’autres actifs fatigués de leur journée, mais aussi des parents pressés et des enfants bien dociles, et puis des personnes âgées qui marchent lentement, des jeunes qui flânent, et des marginaux à l’arrêt. 18 h 30 : il arrive dans le faubourg des Minimes, marche vers sa rue, reconnait le comptable de son association de sport à la boulangerie, puis salue ses voisins. 19 h 30 : il sort de chez lui, avec une bouteille de vin et un paquet de chips et s’installe à la table du repas de quartier de sa rue. Il y passe la soirée. Dans son parcours, ce jeune homme a vécu différentes scènes sociales, qui se distinguent principalement par le degré de connaissance qu’ont les usagers les uns des autres. Or, chaque degré compte pour faire de nous des citadins et des citoyens.
Les variations du jeu social de la rue
La rue est un lieu d’interactions sociales, elle est espace social. Mais selon sa dynamique de fréquentation, elle peut se ranger du côté de l’espace public, anonyme, ou du côté de l’espace de quartier, familier[1]. Il faut regarder son jeu social pour qualifier et caractériser une rue. Si l’on suit l’exemple de ce jeune homme qui travaille dans le centre-ville de Toulouse et habite dans le faubourg des Minimes, on se rend compte qu’au cours de ses pérégrinations, il a fréquenté deux grands types de « rues », ici incarnées par les boulevards du centre-ville de Toulouse et les rues de faubourg qui encerclent le centre-ville[2].
Sur le boulevard, se croisent des publics différents, d’horizons divers. C’est ce qui fait sa singularité en tant qu’espace social. Et cela tient à sa position dans la ville et à sa vocation : être un lieu de passage et de flux, mais aussi de destination, dans un secteur de centralité, aux fonctions riveraines mixtes et attractives (bus et métro, commerces, services, loisirs…). Le boulevard fait ainsi se croiser une somme d’individus, qui ne se connaissent pas mais partagent ensemble la même scène d’usages. C’est ainsi un espace public comme le décrit le sociologue Isaac Joseph, un lieu de coprésence dans l’anonymat d’individus réunis par la fréquentation d’un même espace. Cette coexistence d’inconnus rend compte d’un type de sociabilités particulier, celui des sociabilités publiques, que l’on pourrait aussi appeler des sociabilités de côtoiement. Dans ces sociabilités, on ne se connaît donc pas mais on se côtoie, on est ainsi acteur d’une forme d’interaction, qui se caractérise par son caractère éphémère et anonyme mais aussi par son « autorégulation spontanée », c’est-à-dire qu’on respecte une juste mise à distance les uns des autres pour ne pas tomber les uns sur les autres[3]…
Dans les rues de faubourgs, c’est une autre dynamique sociale qui se joue. Les publics en coprésence sont moins divers, moins variés, l’échelle de fréquentation est plus locale et la rue réunit des individus qui font partie d’un même territoire de vie. De ce fait, les interactions sociales qui caractérisent la rue de faubourg se rangent du côté des sociabilités de quartier ou sociabilités locales, où les relations d’interconnaissances ou de familiarité priment. (Ce qui ne veut pas dire que les sociabilités publiques en sont absentes, mais elles n’y sont pas majoritaires, à l’inverse de ce qu’il se passe sur les boulevards.) On se connaît et on se reconnaît donc plus ou moins dans ce milieu de vie partagé. Les initiatives collectives et partagées, comme les repas de quartier, constituent comme des points d’orgue de ces relations d’interconnaissance.
Passant de l’un à l’autre, du boulevard à la rue de faubourg, des sociabilités publiques aux sociabilités de quartier, ce jeune homme expérimente ou vit des interactions sociales différentes marquées par des degrés de sociabilités différentes. Ainsi, notre jeune homme ne se résume ni ne se réduit à l’une de ces sociabilités. Dans son mode de vie, il vit les deux. Il vit aussi par ailleurs des sociabilités privées, qui sont celles de ses relations amicales, familiales et associatives par exemple. Mais davantage, il faut qu’il vive les deux, et c’est bien là un enjeu pour la ville aujourd’hui que de le lui permettre.
Revaloriser l’anonymat de la rue ordinaire
On sent bien qu’aujourd’hui, dans la ville, les foules solitaires ont mauvaise presse. Encore plus avec le risque sanitaire, peu nombreux désormais sont les discours qui valorisent le va-et-vient anonyme de la rue. À l’inverse, on met en avant les repas de quartier et toutes les initiatives habitantes qui visent à l’appropriation de la rue, c’est-à-dire son activation sociale par l’intensification de ses usages par les habitants. L’enjeu et la généralisation des démarches de concertation qui l’accompagnent concernent la possibilité et la légitimité de s’installer, d’occuper, d’utiliser ces espaces pour des usages autres que le simple fait du passant anonyme. Car être un passant anonyme ne suffit plus, ne suffit pas à la condition du citadin. Ce qui semble aller au-delà du plaisir de l’action collective, c’est finalement la volonté de renégocier sa place en tant qu’habitant, c’est la volonté de participer, de faire et de décider des usages et du devenir de son environnement urbain, et donc de sa rue. « La rue est à nous » est l’expression emblématique de cette volonté de renégocier le rapport entre les institutions publiques qui « gouvernent » la ville (les collectivités) et l’initiative privée qui la fait vivre (individuelle ou collective). Et c’est bien un débat sur les formes de la démocratie dont il s’agit.
Pourtant, il faut bien peser la valeur de l’anonymat urbain. Car ce qui se joue dans la coprésence dans l’anonymat n’est pas rien, au contraire. Sur les boulevards (pour reprendre cette figure type), « chacun peut agir librement parmi les autres, prendre place sans avoir à rendre de compte ni sur ce qui il est, ni d’où il vient », rappelle Michèle Jolé[4]. En maintenant l’indétermination de chacun, la rue des sociabilités publiques et anonymes permet à chacun de trouver sa place, de se sentir autorisé et légitime à être là et à se tenir aux côtés des autres. L’anonymat va donc avec l’accessibilité. Mais parce que cette coprésence sans parole se caractérise aussi par les ajustements que chacun fait pour partager le même espace[5], on comprend aussi que les rapports sociaux dans la rue anonyme soulignent la conscience de l’autre et, plus encore, l’acceptation d’appartenir au même ensemble que les autres : concrètement, la rue, mais symboliquement plus, la société peut-être. La rue est ainsi un espace public ou « l’unité du multiple, c’est-à-dire la cristallisation des uns et des autres dans une même figure »[6].
Le rôle de l’espace public dans la ville
La pratique ordinaire de la rue induit une équivalence entre tous ceux qui s’y trouvent et, par notre façon de la fréquenter, l’acceptation d’un lien avec des inconnus et des étrangers (à soi). En considérant cela, on valorise la dimension politique des rapports sociaux de la rue, et une dimension politique à l’échelle de ses usage(r)s du quotidien. Ce n’est pas seulement dans les mouvements d’appropriation des rues que l’on négocie la relation entre le privé et le public, l’individu et la société : c’est aussi en revalorisant la pratique ordinaire de la rue anonyme pour entretenir et préserver les rapports sociaux qui s’y jouent.
L’on peut s’interroger alors d’abord sur la capacité de la ville à rendre possible ce type de rapports sociaux, et ensuite sur sa capacité à les rendre positifs. Car d’une part, cette expérience du côtoiement avec des inconnus (qui plus est différents de soi) se réduit face à différents phénomènes qui tendent à séparer les groupes sociaux les uns des autres (ségrégations territoriales et séparations sociales) et à freiner l’accessibilité des espaces publics à tous (privatisation et sécurisation). Et d’autre part, les moyens de gestion et de régulation des rues ne sont pas toujours à la hauteur, en particulier dans les espaces urbains ordinaires hors des centres-villes qui concentrent, eux, toute l’attention publique. C’est bien l’enjeu de l’espace public qui se pose, et notamment celui de l’organisation et de la gestion d’une armature urbaine continue de rues, dès lors accessibles et disponibles à la variété des usages sociaux.
[1] Voir les travaux de Perla Serfaty-Garzon, de Louis Quéré ou de Carole-Anne Rivière.
[2] Nous choisissons ici deux types de rues, mais d’autres variations existent encore (cf. l’article de Lionel Rougé sur les rues pavillonnaires).
[3] Voir notamment les travaux de Cynthia Ghorra-Gobin sur ce caractère anonyme et éphémère.
[4] Intervention « L’espace public comme espace du public » lors de la formation continue « Espaces publics, espace public » à l’IEP de Toulouse, co-animée par Pierre Roca d’Huyteza et Céline Loudier-Malgouyres.
[5] Des ajustements dans les gestes et les comportements, c’est « l’inattention civile » d’Erving Goffman. Voir aussi les travaux de Carole Gayet-Viaud d’ethnographie de l’expérience et des épreuves de la coexistence dans les espaces publics, notamment sur la notion de civilité.
[6] BEAUCHARD Jacques et MONCOMBLE Françoise, L’Architecture du vide. Espace public et lien civil, Presses universitaires de Rennes, 2013.